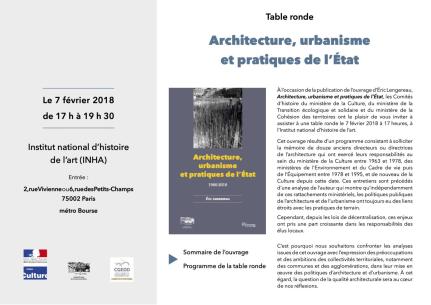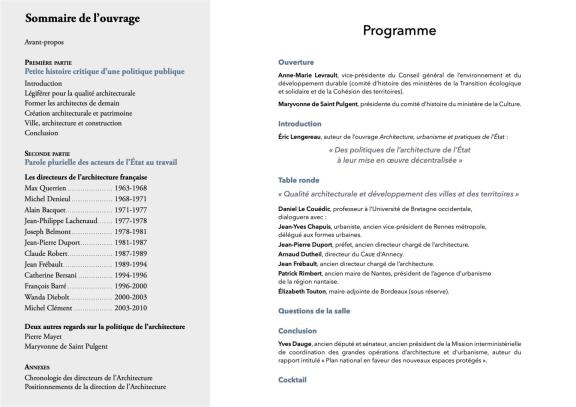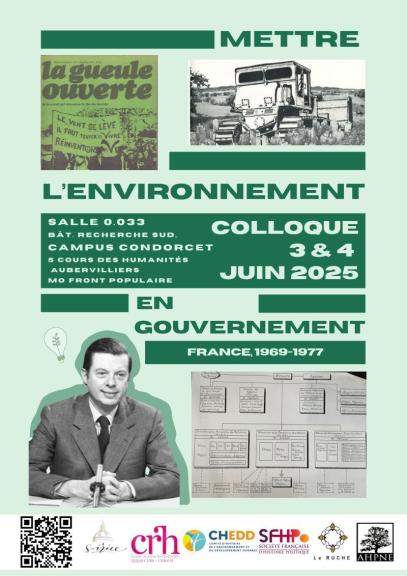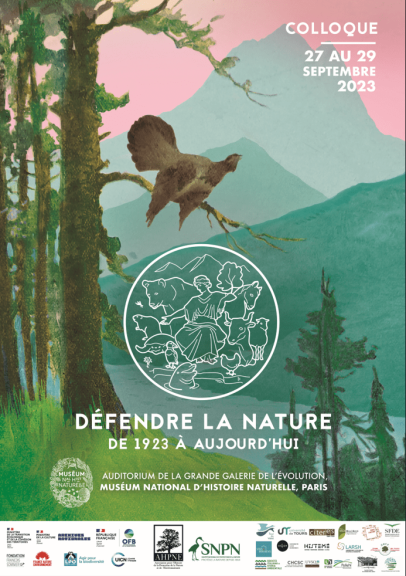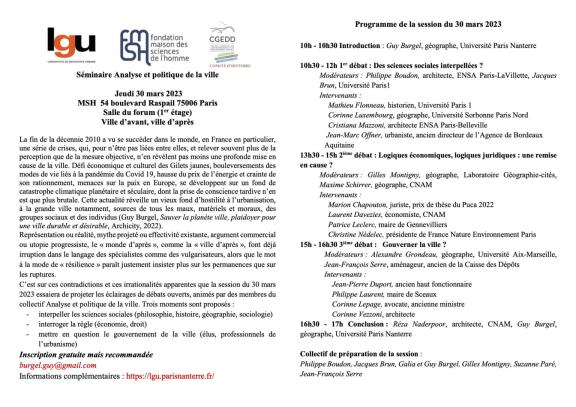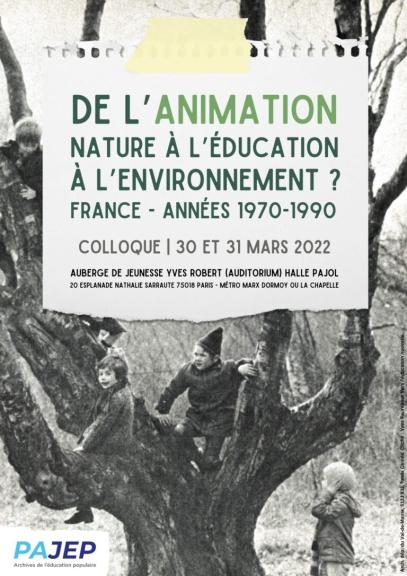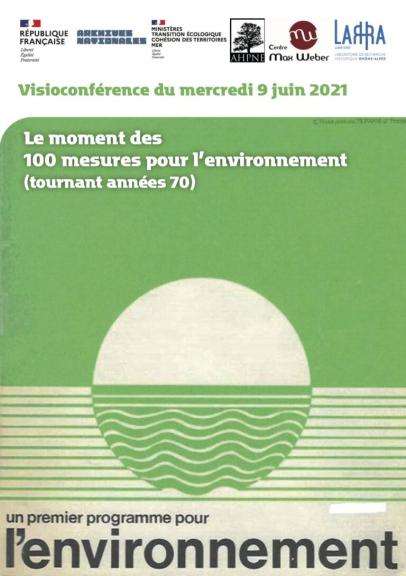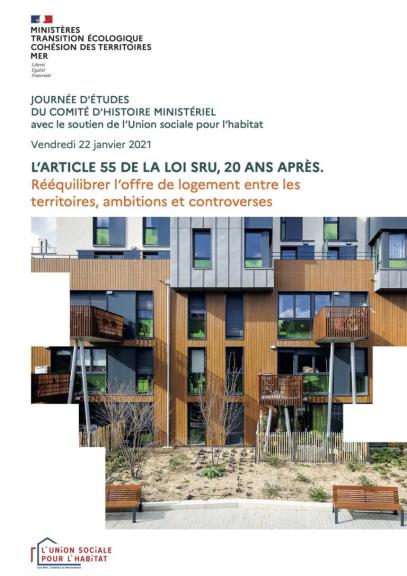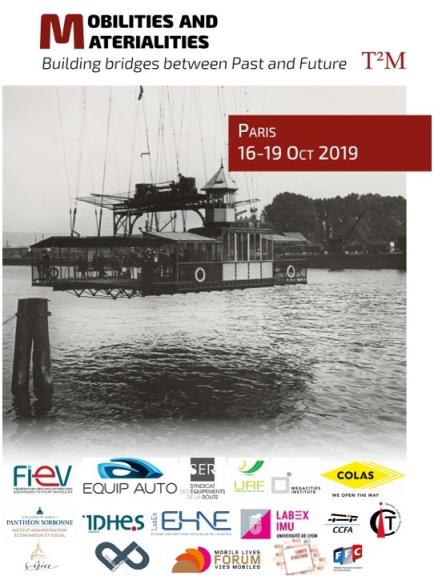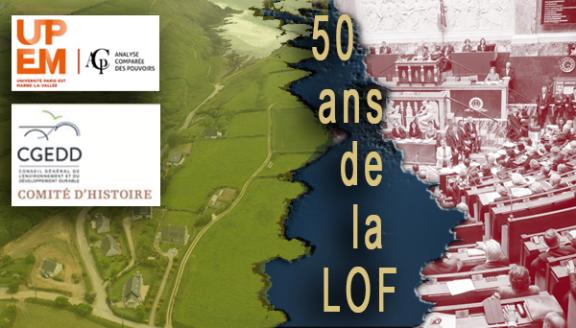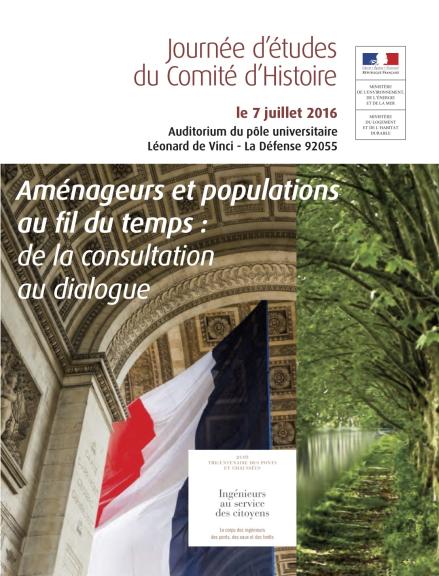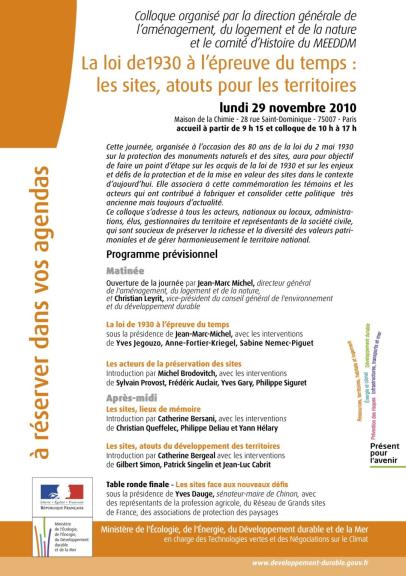Journée d’études
Mercredi 31 mai 2023, 9h00-17h00
Auditorium, Tour Séquoia, site ministériel de La Défense
Sommes-nous en train d’assister à l’invention de la marche comme nouveau paradigme de la conception des villes du XXIe siècle ?
Depuis une quinzaine d’années, la marche en ville s’est imposée comme l’un des champs actifs de réflexion sur la transformation de la ville à une échelle internationale. Dans les années 2010, nombre de grandes métropoles à travers le monde ont mis à leur agenda de grands projets de réaménagement de rues ou de places en faveur des piétons (New York, Barcelone ou encore Paris) en se réclamant de favoriser les mobilités actives. Dans le même temps, le sujet était saisi par les milieux académiques (géographie, sociologie, urbanisme, Staps, etc.), donnant une visibilité sans commune mesure à un thème pourtant parfois traité de longue date par certaines recherches. Enfin, depuis son émergence dans la sphère anglo-saxonne, la notion de walkability – ou marchabilité en français – a même fait de la marche l’un des critères d’évaluation de la qualité des tissus urbains contemporains.
Mais la promotion de la marche en ville, comme enjeu d’aménagement et de politiques publiques, est-elle si radicalement nouvelle ?
En effet, la place du piéton dans la ville est discutée au moins depuis les années 1950 dans le monde occidental. Un temps favorisées dans les années 1970, les politiques de piétonisation ont permis très tôt à certaines villes européennes notamment de se démarquer (Copenhague, Munich, Amsterdam). Dans les années 1980-1990, l’aménagement des espaces publics occupe le devant de la scène, trouvant aussi ses villes phares (Portland, Barcelone, Copenhague à nouveau). Dans quelle mesure la promotion actuelle de la marche en ville s’inscrit-elle dans ces évolutions ? À la croisée d’un examen de la situation actuelle et d’un regard sur la longue durée, le but de cette journée est de questionner l’intérêt croissant pour la marche au moment même où elle semble en passe d’entrer dans le registre de l’action publique.
Cette journée d’étude a vocation à interroger les histoires contemporaines de la marche en ville comme enjeu de politiques publiques, un sujet encore émergent dans la recherche académique. Ouverte aux agents du public et du privé, aux associatifs, aux chercheurs et à toute personne intéressée par le sujet, elle permettra de croiser des interventions de chercheurs (historiens, urbanistes, sociologues…), de témoins du passé et d’acteurs contemporains.
9h00 : Accueil du ministère
9h30-9h40 : Ouverture de la journée par Paul Delduc, Chef du service de l’Inspection Générale de l’Environnement et du Développement Durable
9h40-10h10 : Introduction scientifique : La marche, angle mort des politiques publiques depuis le XXe siècle ? avec Cédric Feriel, Maitre de conférences à l’Université Rennes 2, laboratoire Tempor ; et Arnaud Passalacqua, Professeur à l’école d’urbanisme de Paris, LAB’URBA/LIED.
10h10-10h25 : La marche en ville comme enjeu des politiques publiques contemporaines, avec Thierry Du Crest, Coordonnateur interministériel pour le développement du vélo et de la marche
10h25 : De quoi une politique de la marche en ville peut-elle être le nom ?
L’essor actuel du thème de la marche en ville se trouve associé à plusieurs autres thèmes connexes qui contribuent autant à assurer son succès qu’à brouiller son appréhension : associé aux mobilités (modes doux, modes actifs), rapproché avec le vélo, rattaché au domaine de la santé, de la sécurité routière ou encore à l’hypothèse d’un tournant environnemental… La marche en ville recouvre une diversité qui est aussi riche de potentialités que d’ambiguïtés. Cette session explore l’hypothèse selon laquelle le développement de ce thème vient catalyser des thématiques préexistantes à identifier. Elle mobilise notamment des témoignages d’acteurs qui, entre les années 1970 et 1990, ont participé au sein de l’État, d’associations ou de collectivités, à des initiatives pilotes d’intégration de la marche dans les politiques d’aménagement.
Denis Bocquet, Professeur à l’École nationale d’architecture de Strasbourg, Laboratoire AMUP
Michel-Antoine Boyer, Architecte et paysagiste, membre du groupe d’étude et de recherche du ministère de l’équipement dans les années 197
Anne Faure, Urbaniste, Présidente-fondatrice de Rue de l’Avenir en 1988
Francis Ampe, Ingénieur, urbaniste, ancien maire de Chambéry (1977-1983)
12h00-12h15 : Présentation du dictionnaire pluriel de la marche en ville, avec Sophie Deraëve, Laboratoire Ville Mobilité Transport
12h15-13h30 : Pause déjeuner
13h30-15h00 : La ville à l’aune de la marche, un domaine d’expertise à part entière ?
La construction de la marche comme catégorie d’action publique s’appuie sur des champs techniques variés comme, entre autres, la sécurité routière ou la conception des espaces publics. La session vise à saisir comment différentes expertises se sont renouvelées pour s’emparer de la marche en ville et contribuer, en établissant des ponts entre elles, à inscrire le thème à l’agenda des politiques publiques. Elle croise des interventions de techniciens qui, dès les années 1980 et 1990, se sont emparés du thème « marche en ville » selon différentes perspectives, avec des analyses de jeunes chercheurs ayant travaillé sur l’histoire des expertises et des métiers consacrés aux cheminements piétons
Jean-Marc Offner, Président de l’École urbaine de Science Po
Pauline Detavernier, Docteure en architecture (LIAT), directrice de projet recherche et développement (PCA-STREAM)
Benoît Hiron, Cerema, Responsable de la sécurité et des déplacements, ancien chef du groupe sécurité des usagers et déplacements au CERTU et responsable du comité technique de la Démarche nationale Code de la Rue
Arnaud Passalacqua, Professeur, Ecole d’urbanisme de Paris, LAB’URBA/LIED
15h00-15h15 : Pause
15h15-16h45 : Villes modèles et modèles de marche. Un mouvement municipal international
Les politiques de marche en ville sont depuis longtemps basées sur des expérimentations locales décentralisées. Des villes « modèles » émergent à différentes périodes, comme Copenhague, Barcelone ou encore Portland, et servent d’inspiration et de point de repère pour d’autres cités aux niveaux nationaux mais aussi internationaux. Cette session interroge la manière dont ces circulations de « bonnes pratiques » contribuent ou non à structurer la marche en ville comme nouvelle approche des politiques urbaines à l’échelle internationale. Elle s’appuie notamment sur des études de cas à la fois historiques et contemporaines des villes d’Athènes et de Bruxelles, et sur une analyse du réseau Walk21 dédié à la promotion de la marche et au partage d’expériences à l’international.
Cédric Fériel, Maitre de conférences à l’Université Rennes 2, laboratoire TEMPORA
Jérôme Monnet, Professeur à l’Université Gustave Eiffeil, Laboratoire Ville Mobilité Transport, codirecteur de l’École d’urbanisme de Paris
Dimitra Kanellopoulou, Architecte-ingénieure, maîtresse de conférence à l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais, membre du réseau Walk 21
Claire Pelgrims, MSCA-IF, Postdoctoral research fellow, Université Gustave Eiffel / École nationale des ponts et chaussées
Sylvain Rotillon, Adjoint au coordonnateur interministériel pour le développement du vélo et de la marche
16h45-17h00 : Conclusion, avec Loïc Vadelorge, Professeur d’histoire contemporaine, Université Gustave Eiffel, responsable scientifique du labEx Futurs Urbains, Laboratoire ACP.
Les actes de cette journée d’études ont été édités dans le numéro hors-série 37 de la revue Pour mémoire.