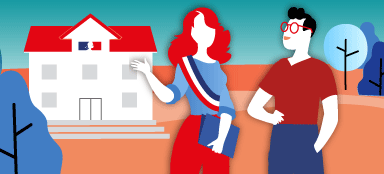Élus locaux : nos ressources pour vous accompagner

Vous êtes élu local et vous avez besoin d’un accompagnement concernant l'aménagement de votre territoire, la transition écologique, le transport, les mobilités, le logement... ? Découvrez les ressources à votre disposition : programmes, plateformes d’aides, guides, kits de communication etc…
Aménager et revitaliser votre territoire
Vous avez besoin d'un accompagnement pour aménager votre territoire ? Retrouvez ici nos ressources et outils à disposition.

Accélérer la transition écologique dans votre territoire
Vous avez besoin d'un accompagnement pour accélérer la transition écologique dans votre territoire ? Retrouvez ici nos ressources et outils à disposition.

Faciliter l’exercice de votre mandat
Réforme du statut de l'élu, simplification administrative, assurabilité... retrouvez sur cette page les principales mesures qui facilitent votre quotidien d'élu local.